« Lycanthrope bien nommé ! Homme-loup ou loup-garou, quelle fée ou quel démon le jeta dans les forêts lugubres de la mélancolie ? Quel méchant esprit se pencha sur son berceau et lui dit : Je te défends de plaire ? » (Baudelaire, L’Art romantique)
« Ce n’est plus l’abrutissement qu’il me faut, c’est le néant!» (Champavert le Lycanthrope, p. 92)
« Yo soy que soy » : telle est la devise de Pétrus Borel, citée par André Breton au début du chapitre qu’il consacre à cet auteur méconnu dans son Anthologie de l’humour noir. La simplicité incisive de ces quelques mots en espagnol semble afficher une fière sérénité, une certitude paisible et altière… Or, l’œuvre de cet auteur inclassable, poète, romancier, s’inscrit toute entière dans l’étrangeté, la recherche frénétique d’une identité, la difficulté de se fondre dans un monde violent et dissonant. Passereau, Champavert, les protagonistes des textes étonnants réunis par Hugues Béesau et Karine Cnudde dans ces Escales à Lycanthropolis, sont-ils des avatars de leur créateur ? Sans doute en reflètent-ils des éclats disparates, en une mosaïque bizarrement cohérente. En effet, ce qui fonde l’harmonie de ce recueil n’est pas tant l’unité thématique – les nouvelles proposant des situations extrêmement riches et variées – que le dynamisme, la violence même, de cette écriture authentique, dramatique et drolatique. Une écriture sous tension, militante, révolutionnaire, sarcastique et désespérée; une écriture romantique…
Qui est le Lycanthrope ? Cette créature mi-homme, mi-loup, c’est Champavert, le héros éponyme de la première escale de notre périple ; un personnage que d’emblée, l’auteur identifie à lui-même. La notice dans laquelle Pétrus Borel présente sa nouvelle est étonnante et introduit immédiatement la problématique de la « pseudonymie ».
« Pétrus Borel s’est tué ce printemps : prions Dieu pour lui, afin que son âme, à laquelle il ne croyait plus, trouve merci devant Dieu qu’il niait, afin que Dieu ne frappe pas l’erreur du même bras que le crime.
Pétrus Borel, le rhapsode, le lycanthrope, s’est tué, ou pour dire la vérité que nous avons promise, le pauvre jeune homme qui se recelait sous ce sobriquet, qu’il s’était donné à peine au sortir de l’enfance ; aussi, peu de ses camarades connurent-ils son véritable nom ; aucun ne sut jamais la cause de ce travestissement ; le fit-il par nécessité ou par bizarrerie ? c’est ce qu’on ignore entièrement. Autrefois ce même nom avait été illustré en littérature et en sciences, par Pétrus Borel de Castres, profond docteur, antiquaire, médecin de Louis XIV et fils du poète Jacques Borel. Descendait-il maternellement de cette famille, avait-il voulu reprendre le nom d’un de ses aïeux ? C’est ce qu’on ignore entièrement et que sans doute on ignorera toujours.
Ainsi que nous l’avons établi en titre de ce livre, son vrai nom était Champavert .» (p. 55-56)
Le lecteur se trouve entraîné dans un univers déconcertant où l’auteur lui-même instaure le doute ; l’identification revendiquée entre auteur et personnage, les éléments autobiographiques introduits dans la fiction consacrent l’œuvre littéraire comme un prolongement de l’existence, lui conférant autant de réalité qu’au vécu. Mais de surprenants développements s’ensuivent : ainsi, Borel-Champavert décrit sa propre mort par suicide – thème récurrent dans plusieurs des nouvelles du recueil. Cette fatalité s’inscrit au fronton de l’œuvre, le premier chapitre de Champavert étant intitulé « Testament ». La mort inéluctable ombre le texte, dont l’humour devient grinçant, dissonant, amer. Le lycanthrope, créature de la nuit, figure un intermédiaire entre la vie et la mort, dans une hésitation qui reflète sans doute les conflits qui animent l’auteur.
Le suicide envisagé aussi bien par Champavert que recherché par Passereau, l’étudiant en médecine héros de la deuxième nouvelle proposée, constitue un motif de l’œuvre de Pétrus Borel – un thème revendiqué avec une ostentation provocante. Si, en 1857, Gustave Flaubert (grand admirateur de Pétrus Borel, comme le rappelle l’exergue choisie pour ces Escales : « Je me gaudys avec Pétrus Borel qui est hénaurme », Lettre à Louise Colet, 1854) a été traîné devant les tribunaux en partie pour avoir décrit le suicide d’Emma dans Madame Bovary, plus de vingt ans auparavant, Pétrus Borel fait de ce thème un aspect essentiel dans Champavert et dans Passereau. La dernière image de Champavert est celle d’un cadavre : le « De profundis » qui clôt le texte évoque la découverte par un écarisseur (orthographe revendiquée par Borel) d’ « un homme couvert de sang ; sa tête, renversée et noyée dans la bourbe, laissait voir seulement une longue barbe noire, et dans sa poitrine un gros couteau était enfoncé comme un pieu. » (p. 121). Un suicide envisagé comme le meurtre de soi-même, ici, et constituant le point d’orgue d’un texte où la violence et la cruauté sont poussées à leur paroxysme – Champavert se suicide après avoir tué la jeune femme aimée, Flava, et l’enfant qu’il en a eu… Mais l’atroce côtoie le rire parfois. Ainsi, dans Passereau, l’étudiant, dont le désespoir se confond avec le blasement, cherche des moyens de mourir volontairement mais pas de sa propre main. Son imagination lui fait envisager un moyen surprenant pour parvenir à ses fins / sa fin : il va trouver le bourreau Samson :
« - Je vous supplie donc de nouveau d’obtempérer à ma demande, je vous tiendrai compte de tous vos frais.
- Quelle demande ? Décidément que désirez-vous ?
- Peu de chose, je voudrais simplement que vous me guillotinassiez. » (p. 172)
Cette demande insolite est formulée de manière raisonnable, argumentée :
« - La vie est facultative, on peut la tolérer à certaines conditions, à la condition du bonheur, et l’on peut, certes, à bon droit, la trancher quand elle ne nous apporte que souffrances ; on m’a imposé l’existence sans mon gré, comme on m’a imposé le baptême ; j’ai abjuré le baptême ; aujourd’hui, je revendique le néant. » (p. 169)
Champavert, dans sa revendication, décide même d’envisager pour sa démarche un cadre légal ; pour cela, il adresse à la Chambre des Députés une lettre incongrue à cette époque de cléricalisme triomphant… Le désir de mourir s’inscrit ainsi dans un décalage qui crée un espace pour l’humour – grinçant, certes, ce qui explique la présence essentielle de l’auteur dans l’anthologie de Breton.
Mais quelle est l’origine de ce désir ? Il semble avoir plusieurs sources. La première, avouée, est l’incapacité à trouver l’amour, le vrai. Les femmes aimées par Champavert et par Passereau ne sont pas dignes de leur amour. Champavert ne ressent qu’aigreur à l’encontre d’Edura, sa « Madame de Warens », qui a « fait entrer la haine en [son] cœur » (p. 103), et dont l’exécration ne peut totalement faire disparaître l’amour. Le jeune homme est aussi déçu par Flava, parce que celle-ci s’est donnée à lui, renonçant à la pureté qu’il aimait en elle. C’est pour cela qu’elle doit mourir. Passereau, lui, a découvert la trahison de Philogène. L’amour lui semble un mirage – la femme n’apporte dans l’existence de ces héros que le désir de mort.
« - Hier, je ne parlais pas ainsi ; hier, j’étais encore abusé, mais bien des voiles sont tombés de mon front depuis hier ; personne n’a été plus que moi plein d’illusions et de croyances, personne n’a été plus sentimental que moi. – Plus le rêve a été grand et beau, plus le plat réveil est douloureux. – Hier j’étais sensible, aujourd’hui je suis féroce. – J’aimais de toutes les puissances de mon être une femme. Je croyais qu’elle avait pour moi de l’amour, elle me jouait ! Je la croyais candide, elle était vile et basse ! Je la croyais naïve, céleste, pure, elle était prostituée ! ô rage ! Et l’amour seul, l’amour pour cette femme me retenait en ce monde ! » (p. 170)
Seule Ulrique, aimée et trahie par le comte Olaüs dans Le Fou du roi de Suède, constitue un contre-motif, introduisant dans le recueil le thème de l’innocence blessée. Mais le texte s’apparente au genre du roman noir du XVIIIe – on pense au Melmoth de Maturin (cité dans la notice introduisant le conte), aux Mystères d’Udolphe d’Ann Radcliffe… La femme est ici une victime de la folie et de l’orgueil des hommes, et non la cause de leur perte.
Or si les héros des récits de Pétrus Borel sont des amoureux déçus, leur mal-être a des racines plus profondes. Les nouvelles accordent une large place au thème du spleen. Voici comment est présenté le début du chapitre IV de Passereau : « Notre écolier a décidément le spleen.- Splénalgie (…) » (p. 155). Les premières lignes de ce chapitre décrivent précisément cet état particulier qui lie l’œuvre de Pétrus Borel à celle de Charles Baudelaire (qui reconnaît la dette qu’il a envers son prédécesseur) :
« Rentré chez lui, Passereau retomba dans une torpeur froide et muette. Habituellement, sa belle figure portait l’empreinte d’une mélancolie profonde mais bienveillante ; ici, ce n’est plus cela : son œil, devenu hagard, est englouti sous des sourcils froncés, sa bouche, qui rit d’un rire d’agonie, est close par ses mâchoires qui claquent et s’enchevêtrent ; ses nerfs se crispent ; il va, il vient ; ses doigts crochus tenaillent et brisent tout ce qu’ils rencontrent ; il se voûte et se ramasse sur lui-même comme une bête fauve blessée ; sa tête, pendante, hoche sans cesse d’une épaule à l’autre, comme la tête de l’aigle presbyte qui cherche à voir la proie qu’il étouffe ; toute sa mimique est infernale et farouche. » (p. 155)
Ainsi, le spleen métamorphose le jeune homme en une créature animale – un aigle « presbyte » ici, prédateur démuni, un loup-garou, monstre qui ne trouve sa place ni chez les humains, ni au sein de la nature. Le monde n’est pas fait pour accueillir les héros créés par Pétrus Borel, car son humanité n’est pas établie… On trouve des accents rousseauistes dans cette œuvre qui inscrit en elle le thème du Mal – dont l’origine est dans la société, sur laquelle Borel pose un regard désespéré.
« Le monde, c’est un théâtre : des affiches à grosses lettres, à titres emphatiques, hameçonnent la foule qui se lève aussitôt, se lave, peigne ses favoris, met son jabot et son habit dominical, fait ses frisures, endosse sa robe d’indienne, et, parapluie à la main, la voilà qui part ; leste, joyeuse, désireuse, elle arrive, elle paie, car la foule paie toujours, chacun se loge à sa guise, ou plutôt selon le cens qu’il a payé, dans le vaste amphithéâtre, l’aristocratie se verrouille dans ses cabanons grillés, la canaille reste à la merci. » (Champavert, p. 97)
L’œuvre de Pétrus Borel porte en elle cette révolte, qu’elle manifeste à la fois par ses motifs et par cette écriture si particulière, qui se caractérise par sa liberté. La poésie y côtoie la brutalité, annonçant celle de Charles Baudelaire. Le Lycanthrope mêle la bourbe, la charogne, la puanteur, à la pureté, aux émotions de ses personnages, à leur mélancolie, dans une écriture foisonnante et émancipée de toute contrainte. Cette liberté s’affirme aussi dans la syntaxe débridée – la ponctuation est étonnante dans ces nouvelles, épousant la violence des sentiments qui s’y expriment. Pétrus Borel revendique la liberté absolue de l’artiste qui peut transgresser les frontières entre les genres et les registres, entrelaçant étroitement la tragédie au grotesque, la beauté et la hideur, la délicatesse et la monstruosité… Une œuvre du seuil, à la fois inscrite dans une histoire et annonciatrice de révolutions littéraires et sociales à venir.
Aussi le lecteur doit-il une reconnaissance absolue aux éditions du Vampire Actif qui ressuscitent un auteur presque oublié par un travail éditorial d’une qualité remarquable…
_______________________________________________________________
Pétrus Borel, Escales à Lycanthropolis, Le Vampire Actif, "Les rituels pourpres", 2010
Baudelaire, L'Art romantique, Garnier-Flammario, 1968
André Breton, Anthologie de l'humour noir, Jean-Jacques Pauvert, 1966
_______________________________________________________________
Et deux beaux articles sur le même livre :
http://latavernedudogeloredan.blogspot.com/search/label/Borel%20Petrus
http://www.e-litterature.net/publier2/spip/spip.php?article1024
Et deux beaux articles sur le même livre :
http://latavernedudogeloredan.blogspot.com/search/label/Borel%20Petrus
http://www.e-litterature.net/publier2/spip/spip.php?article1024

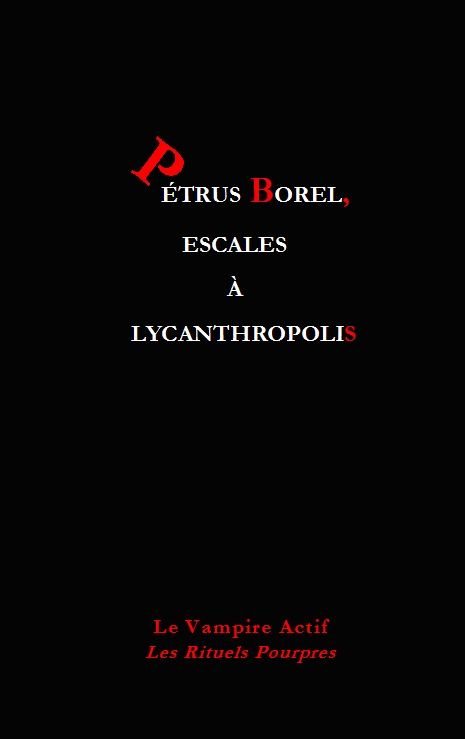

Merci beaucoup pour cette solide chronique, chère Anne-Françoise. Nous sommes très fiers d'occuper une petite place chez toi. Vraiment. Nous espérons que le lycanthrope continuera de rencontrer d'autres lecteurs aussi fins.
RépondreSupprimerLe Vampire Actif est condamné à hanter mon petit blog, et sa place y est grande... Pour ceux qui n'ont pas encore eu entre les mains un exemplaire des Escales à Lycanthropolis, j'insiste sur le magnifique travail de présentation, la mise en contexte, le parallèle établi avec d'autres auteurs... Un ouvrage de référence!
RépondreSupprimerVous êtes convaincante, je l'ajoute à ma pile. Et la nouvelle est mon genre littéraire favori.
RépondreSupprimerMerci, Anna! Puissiez-vous être comme moi séduite par ce Lycanthrope errant aux confins du jour et de la nuit, du rire et du désespoir...
RépondreSupprimerChère Anne-Françoise,
RépondreSupprimerCommme la microbienne Anna de S. (que je salue), j'ajoute ce titre à ma liste de livre "à voler". Une seule raison m'y inciterait : la devise, que dieu déroba à Petrus Borel, et non le contraire, ainsi que le prétendraient quelques ensoutanés chagrins ou grenouilles bénitières.
Mais le garou (à moins que ce ne soit le moine bourru bourré ?), cher à Sganarelle, n'existe pas plus que le susnommé dieu. Ouf !
À bientôt.
Marc. (Pas encore huit heures et je déblatère déjà l'ineptie à la tronçonneuse.)
Je suis certaine, Marc, que ce Lycanthrope est fait pour toi... L'as-tu volé depuis?
RépondreSupprimer