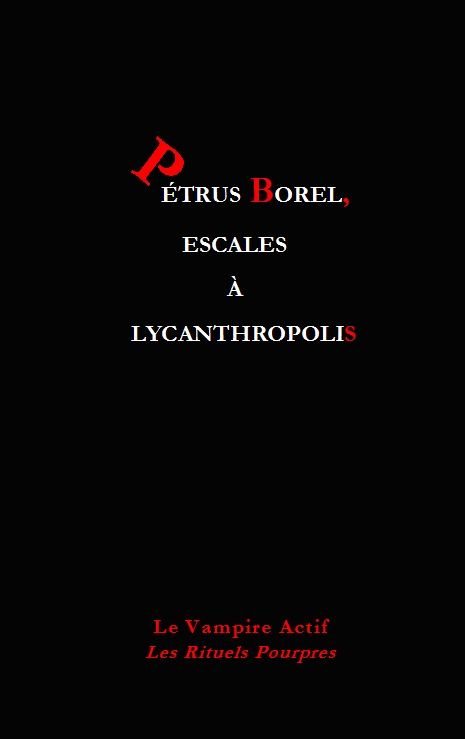Les diverses rentrées littéraires, le flot périodique des livres, comme une marée à la régularité infaillible, ce mouvement qui, avec la ponctualité d’un métronome, enflamme (parfois modérément) les rédactions des magazines et des suppléments culturels, obéit bien souvent à des impératifs plus économiques qu’artistiques. Ainsi, certaines pépites sont malheureusement escamotées au bénéfice d’ouvrages dus à des plumes célèbres, « bankable », chez des éditeurs ayant depuis longtemps pignon sur rue. Les effets de cette loi du marché sont dévastateurs, et la littérature y perd. En effet, des textes importants passent inaperçu, alors que des ouvrages médiocres y gagnent un lectorat qui, finalement, est destiné à se détourner des livres, allant de déception en déception, et n’accordant plus au livre qu’un faible crédit. Dans ce débordement de publications de qualité inégale, il existe pourtant un moyen de se repérer et de trouver le chemin d’une littérature exigeante et pourtant passionnante, suscitant tous les enthousiasmes, redonnant le goût de lire à ceux qui l’auraient perdu : se fier à un éditeur. Certaines maisons d’édition, en effet, se laissent guider par la passion plutôt que de s’inféoder à l’appât du gain ou à des considérations purement commerciales. Elles sont nombreuses, ces petites maisons d’éditions dirigées par des passionnés que le talent et la curiosité insatiable guident vers des trésors littéraires qui sans eux seraient restés enfouis.
La Dernière Goutte est de celles-ci. Créée en février 2008 à Strasbourg par Nathalie Eberhardt et Christophe Sedierta, cette maison d’édition propose déjà au lecteur un riche catalogue de textes variés, d’origines différentes, mais qui ont en commun une très grande qualité. Se côtoient des auteurs éloignés dans le temps et dans l’esprit ; et pourtant, il existe entre eux une parenté définie par le projet éditorial joliment exposé sur la page d’accueil du site de La Dernière Goutte :
« La dernière goutte aime le verbe, les mots, ce qui claque, ce qui fuse, ce qui gifle et qui griffe et qui mord. Les contes cruels, les dialogues acides.
Et les images aussi, irréelles, contrastées,
vénéneuses et absurdes.
Et les images aussi, irréelles, contrastées,
vénéneuses et absurdes.
La dernière goutte met en selle des rêves éveillés qui hachurent la réalité d’un sentiment d’étrangeté.
Elle défend des textes aux univers forts, grotesques,
bizarres ou sombres.
Elle défend des textes aux univers forts, grotesques,
bizarres ou sombres.
Les romans et nouvelles qu’elle publie
reflètent la beauté
qui miroite dans l’ombre. »
reflètent la beauté
qui miroite dans l’ombre. »
Ainsi, les premiers titres édités, déjà, se distinguaient par leur richesse et leur diversité : L’Allégresse des Rats, de Marie-Agnès Michel, fiction d’anticipation qu’Antonio Werli rapproche des œuvres d’Antoine Volodine et de J.G. Ballard (excusez du peu !) ; L’Imposture, roman à quatre mains d’Anne Gallet et D’Isabelle Flaten, qui, au-delà d’une intrigue s’inscrivant pleinement dans un univers contemporain ( un échange amoureux né du hasard, se développant dans la virtualité d’internet), ouvre une réflexion sur l’obsession amoureuse qui se nourrit de fantasme et de dépendance ; Le délit, de Jacques Sternberg, réédition d’un roman publié en 1954, et dont l’aspect prophétique résonne étrangement aujourd’hui ; et enfin, et non des moindres, Mes Enfers, de Jakob Elias Poritzky, roman paru en 1906 en Allemagne, jamais traduit en français, œuvre mordante, violente, d’ailleurs brûlée par les nazis lors d’un autodafé… Depuis, ce catalogue s’est enrichi et propose plus d’une dizaine de titres extrêmement intéressants. J’aimerais en évoquer trois, parus cette année.
En octobre 2009 paraît un magnifique roman de Silvio Huonder, romancier allemand d’origine helvétique – son roman a d’ailleurs en commun avec lui cette géographie à la fois habituelle et étonnante pour le lecteur : en effet, Adalina conduit son protagoniste, Johannes Maculin, de Berlin aux Grisons, région natale du personnage mais aussi de l’auteur. Cette histoire d’amour et de deuil, l’un comme l’autre illusoires, résonne étrangement en ce lieu à la fois inaccoutumé et conformiste, exacerbant les tensions, les sentiments, jusqu’au drame qui, dans un tout autre cadre, aurait pu être banal… Roman à la force étonnante, Adalina entraîne le lecteur dans un territoire dangereux et transgressif, intime et poignant, au-delà des limites de l’humanité, dans une nature heureuse où les hommes créent leur propre malheur… La belle traduction de Dina Regnier Sikirić et Nathalie Eberhardt met en évidence une langue poétique et heurtée à la fois, adaptée aux mouvements de la conscience du personnage confronté à la nostalgie d’un amour et à l’impossibilité de l’oubli. Le roman a été l’objet d’une très belle chronique dans La Taverne du Doge Loredan.
Gabriel Báñez, romancier argentin d’un immense talent, est mort avant d’avoir vu paraître en français son extraordinaire roman Les Enfants disparaissent en janvier 2010, au grand chagrin de Christophe Sedierta, son éditeur. La Dernière Goutte, là encore, offre au lectorat français un texte d’une qualité exceptionnelle, et qui, malgré une apparente simplicité, ouvre une méditation essentielle sur le temps, l’enfance, la mort… Le prétexte pourrait évoquer Hitchcock dans Fenêtre sur cour ou Christian-Jaque avec Les Disparus de Saint-Agil : depuis sa chaise roulante, un horloger est le témoin de disparitions mystérieuses d’enfants, toujours à dix-huit heures précises. Témoin et suspect, il ne propose aucune explication mais oblige le lecteur à entrer dans une réflexion intense et personnelle sur l’enfance, la fuite du temps, l’immobilité et le mouvement … Là aussi, je vous invite à vous reporter à une excellente chronique du doge Christophe Martinez, précise et exhaustive tout en préservant le mystère.
Enfin, je tenais aussi à évoquer l’une des dernières parutions de cette jeune maison d’édition : un livre amer et joyeux, réjouissant et désabusé, celui de Mario Rocchi : Casa Balboa, chronique d’un désordre ordinaire. Une œuvre étonnante, stream of consciousness désenchanté et voluptueux d’un atrabilaire toscan qui pourrait être un reflet de son créateur. Casa Balboa, quinquagénaire grincheux et obsédé sexuel, ne trouve l’apaisement qu’en promenant son chien Otto qui est, en quelque sorte, son double heureux. Il porte sur la société italienne de Berlusconi et de Benoît XVI, sur la famille, un regard blasé et pessimiste. Le roman, s’épanouissant en toute liberté, se développant dans une certaine anarchie, sans pause, sans chapitre, évoque le cinéma italien des années soixante-dix, se plaçant sous la tutelle de Mario Monicelli (« Rien que de penser à la chair de ma chair, ça me donne envie d’être végétarien » est la phrase placée en exergue du livre, tirée du film Mes chers Amis) ou d’Ettore Scola (on pense parfois aux épanchements libidineux du paterfamilias de Brutti, sporchi et cattivi).
Les prochaines parutions de La Dernière Goutte sont tout aussi exaltantes, avec l’annonce pour le 7 octobre 2010 de L’Affabulateur, roman de Jakob Wassermann, auteur allemand surtout connu en France pour Kaspar Hauser ou la paresse du cœur – un roman que personnellement, j’attends avec une immense impatience ; et, pour janvier 2011, la perspective enthousiasmante de découvrir un autre roman de Gabriel Báñez, La Vierge d’Ensenada…
Merci à Christophe Martinez qui, à travers son article sur Les enfants disparaissent, a suscité mon envie de découvrir ce beau roman et, du coup, les autres oeuvres publiées par La Dernière Goutte (PS : merci pour L'Imposture...). Et merci aussi à Christophe Sedierta qui, en buvant un thé au Café Brant, nous a appris que talent, curiosité, passion et modestie peuvent aller de pair...
___________________________________________________________________
Le site de Christophe Martinez, La Taverne du Doge Loredan : http://latavernedudogeloredan.blogspot.com/
Anne Gallet, Isabelle Flaten, L'Imposture, 2008
Silvio Huonder, Adalina (traduction de Dina Regnier Sikirić et Nathalie Eberhardt) , 2009
Gabriel Báñez, Les enfants disparaissent ( remarquable traduction de Frédéric Gross-Quelen), 2010
Mario Rocchi, Casa Balboa, chronique d'un désordre ordinaire (là aussi, très belle traduction de Sylvie Huet), 2010