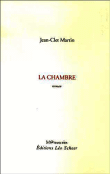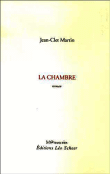
Qu’y a-t-il à l’origine d’un roman ? Trop souvent, le besoin presque maladif de se raconter, de donner une importance démesurée à sa petite vie. Le piège de l’autofiction guette la plupart des auteurs d’aujourd’hui, réduisant l’écriture romanesque à un exercice nombriliste et, il faut l’avouer, peu intéressant pour le lecteur. Mais parfois, le hasard (ou le destin) favorise la rencontre avec un texte hors norme, évitant avec intelligence et brio les embûches narcissiques dans lesquelles tombent très souvent les romanciers d’aujourd’hui. La Chambre de Jean-Clet Martin fait partie de ces heureuses et trop rares surprises…
Cette chambre, lieu clos éclairé par une lucarne traversée par l’intense rayonnement du soleil, est le point de rencontre entre l’intérieur et l’extérieur, mais aussi, de façon différée, entre les trois protagonistes de l’œuvre. Propice à la réflexion, à la solitude, elle se laisse cependant pénétrer par le monde, lumières, sons, effluves provenant de l’extérieur, à la manière d’une monade. Elle conserve en elle l’empreinte des corps qui y ont vécu, à travers des traces (celles d’un cendrier, d’un verre), des objets abandonnés qui prennent au fur et à mesure une place de plus en plus grande, comme cet album consacré à Hopper, qui constitue un lien entre les personnages, mais aussi avec le lecteur. Jean-Clet Martin nous offre ainsi des repères identifiables – la peinture de Hopper, de Manet : en réalité, plus que des repères, les œuvres constituent un départ ou un aboutissement. De nombreuses scènes (j’ose ce terme cinématographique, mais il me paraît refléter la structure du roman) renvoient à Hopper : Marlène et Serge, les futurs amants dans le bar se reflètent dans les personnages de Nighthawks; Pauline, seule dans sa chambre, offre l’image à la fois sensuelle et éthérée de la jeune femme de Morning in a city…

D’ailleurs, ce roman à l’écriture précise et précieuse, taillée et polie comme les faces d’un joyau, concilie sensualité et abstraction, comme Hopper dans ses toiles, à la fois stylisées et fortement marquées par la présence –ou l’absence- des corps. La matière s’allie à l’immatériel ; la vitre crée une frontière en même temps qu’un seuil. Elle isole les êtres du reste du monde, et paradoxalement donne accès à eux. Vitrine ou fenêtre, elle sépare et unit, par la transparence, le rayonnement qu’elle rend possible. Ce lien se prolonge en aura, substance immatérielle d’un corps disparu, par l’imperceptible trace laissée sur la surface brillante d’une table basse. Dans ces objets oubliés, ces marques presque effacées, les morts survivent au néant et à l’oubli.
Pourtant, le livre n’est pas un huis-clos : il propose un parcours qui s’éloigne de la chambre, de la ville, pour conduire très loin deux de ses personnages ! Cette ville sans nom nous devient presque familière : le pont Kamaran, traversé et retraversé, le fleuve aux eaux mouvantes, le bar, le musée, la bibliothèque…Chacun de ces espaces ouvre une réflexion : la bibliothèque évoque le labyrinthe borgésien, le musée est un lieu vivant, où se nouent des intrigues, où le visiteur est parfois un reflet des personnages des œuvres exposées (celles de Hopper). Les toiles du peintre s’animent, au restaurant par exemple où l’œil de Marlène est attiré par un couple qui semble sorti de Chambre à New-York. Chaque déplacement semble constituer un voyage en miniature, comme dans ce bus qui donne l’occasion d’une réflexion sur le point de vue, sur le dépaysement, et même sur la philosophie présocratique ! A travers une étonnante mise en abyme, le lecteur se trouve projeté dans le parcours romanesque des personnages : chaque page recèle une occasion de réfléchir, et Jean-Clet Martin, sans rien imposer, suggère des pistes, distille des références littéraires, artistiques, philosophiques…
Le lecteur peut y suivre son propre chemin : la première lecture de ce roman m’a véritablement happée dans une réflexion sur l’empreinte comme persistance d’un corps au-delà de la mort, comme lien avec l’être disparu. Mais la richesse et la beauté du livre de Jean-Clet Martin se dévoilent à chaque instant ; les méandres de l’intrigue épousent et révèlent nos interrogations existentielles, et, comme par magie, nous offrent des réponses.
____________________________________________________________________
Jean-Clet Martin, La Chambre, M@nuscrits, Editions Léo Scheer, 2009. ____________________________________________________________________
NB:La Chambre est le premier roman de Jean-Clet Martin, qui est philosophe, et auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Voici d'autres lectures qui, je l'espère, vous intéresseront autant qu'elles m'ont passionnée:
100 mots pour jouïr de l'érotisme, Les Empêcheurs de penser en rond, 2004
100 mots pour 100 philosophes, Les Empêcheurs de penser en rond / Le Seuil, 2005
Borges, Une biographie de l'éternité, "Philosophie imaginaire", Editions de l'éclat, 2006
Eloge de l'inconsommable, "Philosophie imaginaire", Editions de l'éclat, 2006 (à lire d'urgence!!!)
Et le tout dernier en date, sorti la semaine dernière:
Une intrigue criminelle de la philosophie - Lire la Phénoménologie de l'Esprit de Hegel, Les Empêcheurs de penser en rond / La Découverte,2009.
 Anselm Kiefer, Claudia Quinta, 2004(photo personnelle)
Anselm Kiefer, Claudia Quinta, 2004(photo personnelle)