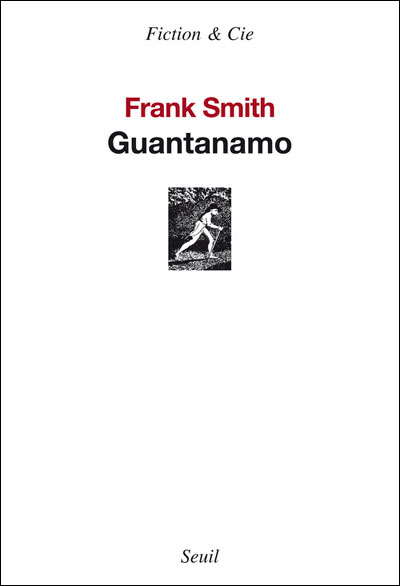« Unscrew the locks from the doors !
Unscrew the doors themselves from their jambs !
Whoever degrades another degrades me,
And whatever is done or said returns at last to me . »
Walt Whitman, Songs of myself, XXIV
« Qu’est-ce que c’est, témoigner ? / Quand est-ce que je vais prêter serment ? / C’est le papier qui porte mon accord ou mon consentement ? / C’est celui qui a été fait avec le représentant personnel ? / C’est aussi celui du représentant personnel ? / Cela ne vous dérange pas ? Dois-je me lever ?
Je vous dirai bientôt quand il faudra prêter serment. / Oui. / Nous allons l’examiner dans une seconde. / Y a-t-il des informations que vous voudriez présenter ? / Voulez-vous prononcer votre déclaration sous serment ? / Non. / Oui, c’est ce que nous voudrions. / Non, ce n’est pas nécessaire.
Frank Smith, Guantanamo
La base américaine de Guantanamo est utilisée comme prison depuis 1991, pour accueillir d’abord des réfugiés haïtiens fuyant le coup d’état de Jean-Bertrand Aristide, puis pour contenir des centaines de Cubains souhaitant émigrer vers les Etats-Unis (certains d’entre eux, porteurs du virus HIV, y demeurèrent jusqu’en 1995). Le destin de ce lieu est aujourd’hui universellement connu : en 2002, des prisonniers en provenance de Kandahar y furent incarcérés dans le cadre de la « guerre contre la terreur » mise en œuvre par George W. Bush. Depuis, elle est devenue tristement célèbre. Ses cages ne s’ouvrent que très rarement ; peu de prisonniers en sont sortis, et parmi eux, rares sont ceux qui ont accepté de briser la loi du silence.
La littérature s’interroge constamment sur le réel, sur la relation subtile et complexe qu’elle entretient avec le monde, source de création revendiquée ou, au contraire, évacuée de l’œuvre au nom de la toute-puissante imagination. En choisissant la base de Guantanamo, prison contestée, symbole de l’omnipotence américaine, Frank Smith, poète, « auteur, avec des mots, avec des images, avec du son », aurait pu quitter la voie de la littérature pour celle du témoignage. Or, ce texte puissant déborde les contours incertains de la réalité pour occuper un espace beaucoup plus arachnéen, celui de la poésie… Les vingt-neuf chapitres de son livre, vingt-neufs dialogues entre détenus et enquêteurs, tissent en effet un délicat entrelacs de mots dont, peut-être, surgira la vérité.
Face à la parole monolithique des autorités américaines se présente une mosaïque de discours : prisonniers Afghans, Pakistanais, Ouzbeks, Yéménites subissent inlassablement un déluge de questions impassibles, répétitives, comme à distance. La parole ici constitue le seul vecteur possible de la vérité. L’éloignement, le confinement dans cet espace îlien, double forteresse cernée à la fois par des murs et par les flots de la mer des Antilles et de l’océan atlantique, rendent impossible tout recours à la preuve. Or, cette parole n’est jamais directe puisque soumise à la traduction et à l’interprétation.
Guantanamo, litanie, chapelet d’interrogatoires qui s’enchaînent les uns aux autres dans de subtiles variations, dessine un monde étrange, instable, dans lequel aucune lumière n’est possible. Les réponses succèdent aux questions, immuablement, subissant de légères oscillations, créant un entrecroisement de fils incapables de se nouer, se défaisant sous la plus faible traction. Les mots ne peuvent unir ; les discours se superposent sans jamais s’effleurer, ouvrant un abîme d’incompréhension. La voix américaine, toujours polie mais d’une implacable neutralité, irrespectueuse dans cette courtoisie même, cette froideur calculée, tente de briser toute tentative d’intimité. L’accusé, lui, tente parfois d’apitoyer son interlocuteur, d’introduire dans ce dialogue une forme d’humanité, avec les armes des vaincus : la pitié, l’obséquiosité, et, parfois, une agressivité – qui ne se libère jamais totalement.
« Question : Pourriez-vous nous dire ce que nous auraient rapporté vos témoins s’ils avaient pu venir ? En premier lieu votre frère Q.K., si c’est avec lui que vous avez été arrêté ?
Réponse : Oui, c’est avec lui. Il a été arrêté, puis libéré.
Question : Que nous aurait-il dit concernant votre détention qui puisse aider ce tribunal ?
Réponse : Il vous aurait dit que je suis un homme pauvre, que je suis kuchi et que je n’ai jamais rien fait de mal dans ma vie.
Question : Et votre cousin M. ?
Réponse : Il vous aurait dit la même chose, que je suis un homme pauvre, que je suis kuchi et que je n’ai jamais rien fait de mal de ma vie.
Question : Qui vous a capturé ?
Réponse : Des militaires afghans.
Question : Lorsqu’ils vous ont capturé, étiez-vous armés ?
Réponse : Non.
Question : Est-ce que vous aviez un appareil photo, ou eu accès à quelqu’un qui détenait un appareil photo ?
Réponse : Je ne sais pas ce que c’est un appareil photo (…) ». (p.83-84)
La parole, ainsi, est prisonnière d’un jeu aux règles truquées, régies par la loi du plus puissant, le riche, celui qui est dans son bon droit… Deux conceptions du monde s’affrontent, incapables de se rejoindre, dans une séparation inéluctable. Des scènes ancestrales semblent se rejouer ici, où la maîtrise du langage devient gage de pouvoir, comme chez ces Grecs de l’Antiquité dont Philoctète craignait la parole menteuse. Le rapport au langage qui se construit dans l’œuvre de Frank Smith puise ses racines au cœur d’un univers inexprimable. Cette question semble le hanter : « On perçoit par intermittences un langage lourd de ce qu’on ne connaît pas vraiment » (Frank Smith, Dans Los Angeles). Le détenu de Guantanamo a été transporté (déporté ?) dans un monde dont les clés ne lui sont pas offertes. Or, si le rapport au monde s’exprime par les mots, comme inscrire dans ce monde sa vérité ? On pense à la lumineuse analyse du langage humain produite par Walter Benjamin : « Autrement dit, l’homme communique sa propre essence spirituelle dans le langage. Or, le langage humain parle dans des mots. Par conséquent, l’homme communique sa propre essence spirituelle (autant qu’elle est communicable) en nommant toutes les autres choses. » Si on lui demande de nommer l’innommable, ou si ce que l’on nomme devant lui n’existe pas dans son monde, comment l’homme peut-il espérer être reconnu en tant qu’humain ? Son âme est niée, le reléguant au rang d’objet – il est celui qui ne sert qu’une cause, celle du vainqueur. La maîtrise du langage confère la force ; son insuffisance est la plus grande des faiblesses. « L’homme est offert, livré par son langage, trahi par une vérité formelle qui échappe à ses mensonges intéressés ou généreux. La diversité des langages fonctionne dans une Nécessité, et c’est pour cela qu’elle fonde un tragique », écrit Roland Barthes. Le langage, force des uns et faiblesse des autres, initie le rapport qui se joue. L’œuvre de Frank Smith touche à l’intangible, créant, par l’ouverture d’un espace poétique, une magnifique réflexion sur la liberté ou la sujétion immanentes au langage, dont le pouvoir est de distribuer les rôles dans ce War Game désespéré et aux conséquences désastreuse, puisqu’ici, au lieu d’unir, les mots séparent, désagrègent, anéantissent…
Frank Smith, Guantanamo, Editions du Seuil, collection "Fiction et Cie", avril 2010
Walter Benjamin, "Sur le langage en général et sur le langage humain", lettre à Gershom Scholem, 1916, in Oeuvres I, Folio, 2000
Roland Barthes, "L'écriture ou la parole", in Le degré zéro de l'écriture, Seuil, 1972.