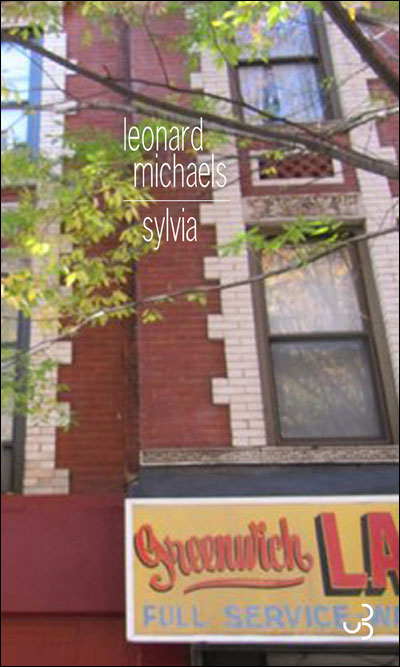« Bien et mal sont les préjugés de Dieu, disait le serpent ». (Nietzsche, Le Gai Savoir, III, 108)
« Dieu est mort ; mais tels sont les hommes qu’il y aura peut-être encore pendant des millénaires des cavernes dans lesquelles on montrera son ombre… Et nous…, il faut encore que nous vainquions son ombre. » (Le Gai Savoir, III, 259)
Père des mensonges ( Father of lies), dont la publication toute récente en français ne doit pas faire oublier qu’il s’agit d’un roman paru il y a une douzaine d’années aux Etats-Unis, bien avant Contagion et La confrérie des mutilés, pourrait, à un premier niveau, ne se lire que comme le récit – non linéaire et polyphonique – de crimes pédophiles commis dans l’Eglise, thème particulièrement en vogue ces derniers temps. Or, en donnant une voix au criminel, Brian Evenson n’inscrit pas son œuvre dans le sensationnel, mais engage une réflexion puissante sur la religion, le mal, la relation à la divinité ou au démon, et contraint le lecteur à se pencher sur sa propre perception du fait religieux. L’Eglise (ecclesia, assemblée) est le carcan qui emprisonne tous les personnages du roman (et qui n’est abandonné que lors d’un bref détour dans un autre univers oppressant, l’hôpital ), hiérarchisée selon un système rigoureux qui évoque l’Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours, la secte mormone, de laquelle l’auteur s’est dissocié après y avoir grandi. Le protagoniste, Eldon Fochs, en est un dignitaire, un Doyen, amené par sa femme à consulter un psychothérapeute, qui lui aussi appartient à cette église. Il lui confesse d’étranges rêves pleins de violence et de fureur, et lui découvre indirectement son attirance pour de jeunes garçons qu’il éduque à la foi sanguiste .
Le récit emprunte différents chemins et différentes voix : il débute par la correspondance entre Feshtig, le thérapeute, et son directeur, lui-même sous la pression des plus hauts dignitaires de la congrégation. Il importe à l’Eglise de faire obstacle à la révélation, le mal doit rester caché, tu ; la loi du silence bafoue le droit des victimes, faisant d’elles des coupables au besoin, pour protéger le criminel, non personnellement, mais en tant que représentant de cette église. Ensuite, le rapport de Feshtig nous propose une approche objective, mais nuancée d’humanité par l’inquiétude légitime du psychothérapeute. Puis la parole est donnée à Fochs lui-même, le criminel, parole multiple car l’homme se dit guidé par une voix incarnée en un « homme fait de souffle » qui l’incite à commettre sévices, viols et assassinats. Cette schizophrénie semble à la fois propre au personnage, mais aussi générée par le milieu dans lequel il exerce ses fonctions, puisque l’individu doit céder le pas à l’homme d’Eglise (Brian Evenson s’explique sur l’influence qu’a exercé sur lui l’œuvre de Deleuze et Guattari dans le remarquable entretien qu’a mené avec lui Eric Bonnargent – Bartleby, et que vous trouverez ICI).
La structure narrative de l’œuvre est à la fois simple et rigoureuse, alternant les pressions ecclésiastiques, l’investigation psychique et le point de vue de Fochs. Le mot « anamnèse », qui introduit le rapport de Feshtig, est particulièrement intéressant, puisqu’il joint les différents niveaux de sens du récit : le plan philosophique et platonicien, l’anamnèse (ανάμνησις, action de rappeler le souvenir) étant le souvenir de l’idée de l’âme dans le ciel des idées, réminiscence nécessaire à l’incarnation de celle-ci ; le plan médical, l’anamnèse constituant le récit par le patient de ses antécédents médicaux et de ses symptômes – c’est la phase qui rassemble Festig et Fochs ; et surtout le plan religieux, l’anamnèse correspondant ici au rappel des souffrances et de la résurrection, au moment de l’Eucharistie qui donne chair au Christ. Or, Fochs est sous l’emprise d’une voix intérieure, ce fameux « homme fait de souffle », qu’il associe souvent au Christ, se dédouanant ainsi de l’horreur des actes commis : ils étaient justes, puisqu’inspirés par le Sauveur… Mais ses certitudes se fissurent parfois, et le doute s’installe : est-ce Dieu ou le diable ? Quelle que soit la réponse, l’Eglise choisit de protéger le criminel, dont le mensonge, bien qu’éventé, demeure la seule défense, acceptée malgré l’évidence. La parole a suffi à contredire les actes : cette prévalence du verbe n’est-elle pas le reflet des exigences de la foi ? La mise en cause de la croyance religieuse est violente et implacable : en son nom, tout est permis, y compris le pire, à condition qu’il reste inavoué. Evenson semble s’insinuer dans les pas de l’Insensé du Gai Savoir, reprenant à son compte cette question rhétorique : « Que sont donc encore les églises sinon les tombeaux et les monuments funèbres de Dieu ? » (III, 125).
Mais au-delà de la question de Dieu, du bien et du mal s’insinue également l’énigme de l’Autre : qui est cet autre que je ne suis pas ? Ou alors, se peut-il qu’il ne soit qu’une émanation de moi ? Dans le roman, l’Autre est celui qui inspire à Fochs toutes ses exactions, et qu’il distingue de lui-même sans doute par incapacité à en assumer pleinement la responsabilité. S’opère alors une démultiplication de ses personnalités, qui prennent des visages insaisissables et non identifiables. Cependant, Fochs nie l’idée qu’il soit habité par d’autres : « Non, il n’y a personne de ce genre à l’intérieur de moi. » Le mal est donc parfaitement extériorisé, relégué hors du territoire de l’humain, presque. Il s’incarne en l’Autre impalpable, prend souvent l’apparence d’un homme à la tête sanglante, mais se métamorphose selon les circonstances en vieillard, en malade à l’hôpital, en médecin… Impossible épiphanie ! Sans visage, il ne présente aucune possibilité de devenir un autrui absolu permettant l’existence d’un Moi – je ne puis être moi-même si l’autre n’a pas de visage reconnaissable et distinct du mien, je ne puis être libre : « Le visage où se présente l’Autre – absolument autre – ne nie pas le Même , ne le violente pas comme l’opinion ou l’autorité ou le surnaturel thaumaturgique. Il reste à la mesure de celui qui accueille, il reste terrestre. Cette présentation est la non-violence par excellence, car au lieu de blesser ma liberté, elle appelle à la responsabilité et l’instaure. Non-violence, elle maintient cependant la pluralité du Même et de l’Autre. Elle est paix. » (Emmanuel Levinas, Totalité et infini, p.222).
L’individu, renonçant à sa responsabilité, perd ainsi sa liberté, récupérée par l’institution religieuse. Le mal triomphe dans le silence imposé ; la vérité capitule devant le système ; l’homme n’est plus qu’un rouage dans le mécanisme qui s’apprête à le broyer…
PS: ce texte, légèrement modifié grâce à JCM, est paru sur son blog Strass de la philosophie, sous le titre "Autrement Autre..."
D'autres romans et nouvelles de Brian Evenson:
La confrérie des mutilés, Le Cherche Midi, Lot 49, 2008
Vitrine à San Francisco, juillet 2009 (photo personnelle)
Inversion, Le Cherche Midi, Lot 49, 2006
Contagion, Le Cherche Midi, Lot 49, 2005
A propos de La Confrérie des mutilés (ou plutôt, de sa deuxième partie, Derniers jours, les deux romans, se faisant suite, publiés en français en un volume), je vous invite à lire la magnifique analyse de Marcel Inhoff sur son blog Shigekuni (en anglais) : Bloody Hell : Brian Evenson's "Last Days"
Et, toujours pour mes lecteurs anglophones, un entretien mené sur Bookbabble par François Monti (Fric Frac Club), Marcel Inhoff et d'autres...
PS: ce texte, légèrement modifié grâce à JCM, est paru sur son blog Strass de la philosophie, sous le titre "Autrement Autre..."
D'autres romans et nouvelles de Brian Evenson:
La confrérie des mutilés, Le Cherche Midi, Lot 49, 2008
Vitrine à San Francisco, juillet 2009 (photo personnelle)
Inversion, Le Cherche Midi, Lot 49, 2006
Contagion, Le Cherche Midi, Lot 49, 2005
A propos de La Confrérie des mutilés (ou plutôt, de sa deuxième partie, Derniers jours, les deux romans, se faisant suite, publiés en français en un volume), je vous invite à lire la magnifique analyse de Marcel Inhoff sur son blog Shigekuni (en anglais) : Bloody Hell : Brian Evenson's "Last Days"
Et, toujours pour mes lecteurs anglophones, un entretien mené sur Bookbabble par François Monti (Fric Frac Club), Marcel Inhoff et d'autres...