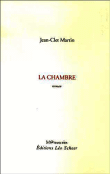American Visionnary Art Museum, Baltimore, juillet 2009 (photo personnelle)
American Visionnary Art Museum, Baltimore, juillet 2009 (photo personnelle)"C’était moi l’ombre du jaseur tué
Par l’azur trompeur de la vitre ;
C’était moi la tache de duvet cendré – et je
Survivais, poursuivais mon vol, dans le ciel réfléchi."
Feu pâle, long poème de John Shade en quatre chants, constitue plus que le prétexte de cette œuvre étrange, toute en ombres et en reflets. Un lecteur candide ou peu familier des malicieuses manipulations de Vladimir Nabokov pourrait pénétrer dans cette œuvre en ignorant que la fiction débute dès la première ligne : en effet, si le poème occupe apparemment la place centrale dans le livre, sa présentation et ses annotations en font partie intégrante. Ainsi, auteur (Shade) et éditeur (Kinbote) sont les deux protagonistes de ce texte intrigant qui en réalité se définit comme un roman, puisqu’il s’agit d’une fiction le plus souvent narrative. Un étrange dédoublement, car Kinbote, voisin voyeur et obsédé par l’idée de la mission à accomplir, s’introduit de force dans l’existence du poète, puis dans son œuvre, le commentaire envahissant le poème, le commentateur voyant en Shade une image de son destin - rocambolesque pour le moins.
Que de pièges, de chausses-trappes, de méandres dans cette œuvre aux multiples niveaux de lecture ! Il est impossible d’en résumer les péripéties, tant elles sont nombreuses, surprenantes et… compliquées. Mais là n’est pas l’essentiel. En effet, se tisse entre Shade et Kinbote une relation indescriptible, et peut-être peu goûtée par le poète, ou alors tout simplement fantasmée par son zélateur. Petit à petit, à mesure que le poème semble s’étioler (ses premiers vers, magnifiques, perdent peu à peu leur mystère et laissent progressivement la place à une simple autobiographie versifiée), le commentaire prend de l’ampleur, Kinbote y laissant libre cours à une sorte de délire de persécution et une identification de plus en plus nette du poème avec sa propre existence, comme s’il s’était incarné en Shade ou que celui-ci ait pu s’immiscer dans sa conscience.
Au-delà de l’érudition commune à Kinbote et à Nabokov (on retrouve dans l’œuvre la prédilection de celui-ci pour l’entomologie, la botanique, l’ornithologie, comme dans Ada ou l’ardeur) et de l’humour dont il fait preuve, Feu Pâle présente au lecteur un miroir, l’incitant à une réflexion poussée sur le processus de lecture et d’écriture. En effet, le texte de Shade n’existe que parce que Kinbote désire plus que tout le lire ; et l’écriture (romanesque, ou plutôt fantasque) naît de cette lecture. Les premiers vers du poème semblent définir cette relation : l’oiseau (le jaseur, celui qui ne cesse de parler – n’oublions pas que Nabokov a attentivement et scrupuleusement supervisé la traduction en français de son roman) traverse la vitre, survivant à sa propre mort ; une vitre plutôt qu’un miroir, car le miroir reflète assez fidèlement la réalité alors que le reflet dans la vitre est ombré, tremblé, presque effacé par la transparence même qui au lieu de révéler dissimule. Cette fenêtre sur le monde est une ouverture mais aussi une cloison, un mur sur lequel on peut se fracasser… De l’horrible danger de la littérature ! Shade d’ailleurs le paie de sa vie, assassiné par un tueur dont on ne sait qui il poursuit réellement (ne serait-ce pas plutôt Kinbote qui était visé ?). Deux destins se rejoignent ou plutôt se succèdent : la mort de Shade confère à Kinbote, le lecteur, le pouvoir de poursuivre l’œuvre à sa manière par le processus de l’interprétation.
Mais que reste-t-il à la fin ? « Le feu pâle de l’incinérateur » dans lequel le poète brûle régulièrement toutes ses ébauches ? Ou alors le face à face meurtrier auquel Kinbote continue à s’attendre ? Nabokov nous égare, mais nous rappelle que toute œuvre littéraire se nourrit de la citation des autres : il convoque ainsi Goethe, Proust, Dostoïevski, Robert Browning, Joyce et… lui-même (à travers des allusions à Lolita ou à Pnine), plaçant son roman sous le signe du plus mystérieux de ses prédécesseurs, Shakespeare :
« The moon’s an arrant thief,
And her pale fire she snatches from the sun… »
(La lune est une voleuse de grand chemin, / Sa pâle lumière, elle la fauche au soleil…, Timon d’Athènes, IV, 3).
La littérature est transmission, mais aussi tromperie, illusion ; le regard qu’elle pose sur le monde n’est jamais figé mais insaisissable. La vérité de l’auteur n’est pas celle du lecteur, elle ne vaut pas mieux non plus, mais l’une et l’autre se complètent, s’enrichissent dans une spirale vertigineuse.